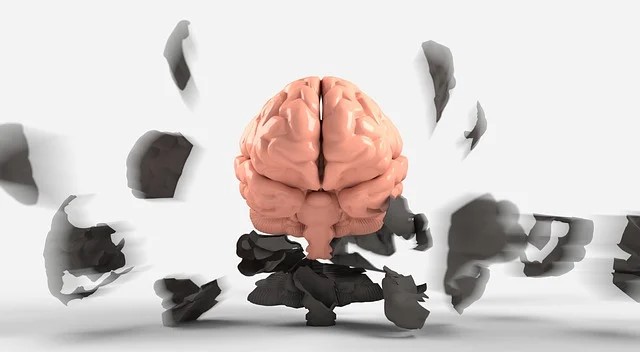Résumé Les signaux socio-émotionnels externes sont-ils perçus différemment par le cerveau selon les états internes de notre corps ? Dans cette étude, nous évaluons si la perception des états émotionnels des autres dépend d’états intéroceptifs internes, combinant des mesures multimodales (expériences comportementales, électrophysiologie, anatomie cérébrale et connectivité du réseau cérébral) chez des témoins sains et des patients atteints de maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer, Parkinson et démence frontotemporale). Notre étude suggère que si les gens se concentrent sur leurs propres états corporels internes (intéroception cardiaque), la perception des émotions s’améliore, accompagnée de modulations aux niveaux comportementaux, électrophysiologiques, neuroanatomiques et de connectivité cérébrale. De plus, la démence frontotemporale, affection caractérisée par des déficits socio-émotionnels, présente des marqueurs neurocognitifs convergents et multimodaux de perturbations intéroceptives au cours du traitement émotionnel (déficits comportementaux sélectifs, modulations des potentiels évoqués anormaux du cœur, atrophie insulaire-cingulaire et altérations du réseau de saillance), par rapport aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson et aux témoins. Ces résultats soutiennent un modèle de codage prédictif des émotions basé sur les états intéroceptifs, proposant également une charge allostatique inadéquate dans la démence frontotemporale. |
| Tout est selon le corps avec lequel vous regardez |
Le monde extérieur qui nous entoure n’est pas perçu de manière réflexive ou passive. Nous apprenons à percevoir la réalité sur la base de notre propre tissu de sens qui offre à chacun de nous des perspectives partiellement similaires et partiellement différentes. Le poème de Ramón de Campoamor déclare magnifiquement « que dans le monde perfide / il n’y a ni vérité ni mensonge : / tout est selon la couleur / du verre avec lequel on regarde », capturant le regard intérieur avec lequel nous percevons et agissons dans le monde.
Les neurosciences cognitives se sont beaucoup consacrées à comprendre comment notre cerveau perçoit le monde extérieur (notamment dans le cas de notre système visuel), oubliant souvent que le cerveau est lui-même un cristal qui établit notre perception. Cependant, les approches actuelles de la cognition située et incarnée nous rappellent une fois de plus que notre corps et ses circonstances sont plus qu’un simple filtre puissant à travers lequel nous observons la réalité.
En particulier, l’importance des signaux internes de l’organisme issus de l’étude de l’intéroception - processus par lesquels le cerveau censure, intègre et envoie des informations sur les états corporels - a acquis une importance considérable. Imhotep , en Égypte, a prévenu il y a plusieurs millénaires que le flux sanguin cardiaque influençait le cerveau, et certains philosophes grecs ont proposé que le cœur et les intestins soient les moteurs de l’esprit.
Mais c’est William James, philosophe et psychologue américain, qui suggéra bien plus tard que la perception des émotions avait une base corporelle. Pour lui, l’origine des émotions venait des viscères. Plus tard, Sherrington a introduit le terme intéroception . Malgré cela, il a fallu du temps pour que le corps joue un rôle de premier plan dans les neurosciences cognitives contemporaines.
| Les émotions des autres sous le verre de notre corps |
Les processus intéroceptifs peuvent être évalués de manière très simple, par exemple à travers des tâches dans lesquelles les participants suivent leur rythme cardiaque . Sur la base de cette tâche, un nouvel agenda clinico-thérapeutique a émergé pour de multiples maladies psychiatriques et neurologiques, notamment la dépression, l’anxiété, l’anorexie, la dépression, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension, la démence et les troubles dits fonctionnels. Plus récemment, il a été suggéré que les processus intéroceptifs pourraient avoir un impact sur la cognition sociale (empathie, prise de décision sociale) et sur les émotions.
La théorie du codage prédictif intéroceptif propose que les états intéroceptifs soient utilisés dans les prédictions futures (ou inférence bayésienne) basées sur des expériences corporelles antérieures, ce qui colore la perception des phénomènes sociaux externes . Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas été possible de démontrer de manière cohérente que le changement des états intéroceptifs modifie également la perception du monde social externe et de ses corrélats cérébraux.
| Comment notre corps affecte la perception des émotions et comment celle-ci est affectée par les maladies neurodégénératives |
Les neurosciences cognitives et la neurologie comportementale ont commencé à mettre en évidence les états intéroceptifs comme modulateurs centraux des émotions (et particulièrement des émotions négatives, comme le dégoût, la colère ou la rage). Cependant, le domaine manque de modèles expérimentaux permettant de manipuler la perception des émotions via l’intéroception et ses corrélats cérébraux.
Dans cette étude, nous avons conçu une tâche expérimentale qui implique des conditions de concentration intéroceptive cardiaque (écouter son propre rythme cardiaque) et de contrôle extéroceptif (écouter un son éternel) suivies de la présentation d’émotions faciales dans lesquelles les participants doivent reconnaître le type d’émotion. . .
Nous avons recruté 114 participants, y compris des témoins sains et des patients atteints de démence frontotemporale à variantes comportementales (bvFTD), de la maladie de Parkinson (MP) et de la maladie d’Alzheimer (MA). Au cours de la tâche, nous avons mesuré les modulations de l’activité cérébrale corticale (avec EEG, évaluant le potentiel évoqué cardiaque, ou HEP) et leur association avec des modèles d’anatomie et de connectivité fonctionnelle.
Au niveau des performances, seuls les patients bvFTD ont présenté des déficits dans le suivi de leurs états corporels intéroceptifs par rapport aux témoins. Dans ce dernier cas, le ciblage intéroceptif cardiaque a généré une meilleure reconnaissance des émotions négatives (par rapport à la tâche de contrôle), mais cet effet a été annulé chez les patients atteints de bvFTD. L’activité corticale cardiaque (HEP) a augmenté lors de la reconnaissance d’émotions négatives, mais uniquement dans les conditions de focalisation intéroceptive cardiaque, à la fois chez les témoins et chez les patients atteints de MA.
Dans tous les groupes, la reconnaissance des émotions négatives au cours de la tâche de focalisation intéroceptive cardiaque était associée à une augmentation du volume de l’ insula et du cortex cingulaire antérieur , deux régions cruciales de la régulation intéroceptive et allostatique. De plus, la reconnaissance des émotions négatives était associée à la connectivité du réseau de saillance (un réseau intéroceptif-allostatique) dans la tâche de focalisation intéroceptive cardiaque et au réseau exécutif dans la condition de contrôle du stimulus externe.
L’activité du réseau de saillance était altérée en relation avec la reconnaissance émotionnelle intéroceptive dans bvFTD. Ensemble, nos résultats suggèrent que les états intéroceptifs façonnent la reconnaissance des émotions et leurs corrélations cérébrales, tout en révélant un marqueur physiopathologique spécifique du bvFTD. Ces résultats constituent un programme théorique et clinique prometteur pour comprendre l’intéroception, l’émotion, l’allostasie et la neurodégénérescence.
| Ramener le corps à la perception de la réalité |
L’étude de l’interaction entre les signaux corporels internes et les émotions fait l’objet d’une longue controverse dans les domaines des neurosciences cognitives, de la psychiatrie, de la neurologie et des disciplines connexes. Cette étude, conjointement avec d’autres résultats, a des implications théoriques et cliniques. La construction d’états corporels subjectifs imprègne de multiples processus de perception externe.
Étant donné que le traitement des émotions des autres (et d’autres objets externes) semble dépendre de sa propre perception viscérale, de nombreuses pratiques cliniques pourraient être améliorées par une meilleure compréhension de l’intéroception. Cela devient une composante essentielle de l’allostasie , l’anticipation basée sur les besoins physiologiques et les états internes, des signaux externes et du contexte. Cela ouvre de nouvelles voies pour un programme clinique à l’intersection des neurosciences cognitives, de la psychiatrie et de la neurologie cognitive .
Apparemment, le cerveau utilise les états internes du corps pour anticiper les besoins du contexte et définir les réponses les plus adaptatives.
Dans le cas des battements cardiaques et d’autres signaux viscéraux, cela suggère que la perception d’informations socio-émotionnelles externes est un processus actif basé sur ses propres expériences antérieures ainsi que sur ses attentes contextuelles. Autrement dit, la perception de la réalité externe est une co-construction d’un récit interne .
Bien que cette conclusion puisse paraître purement philosophique, et même être interprétée à tort comme du solipsisme de Berkeley , je pense qu’elle ouvre de nouvelles possibilités. Les cliniques multidisciplinaires pour les maladies physiques et mentales nécessitent de nouvelles approches qui clarifient le fonctionnement de ces processus subjectifs et corporels qui se produisent chez les patients.
Un exemple clair en est celui des troubles fonctionnels (qui impliquent généralement des affections cardiovasculaires, gastro-intestinales ou des douleurs chroniques), dans lesquels la mauvaise compréhension par les médecins des états intéroceptifs ou subjectifs des patients conduit souvent à une surmédication, à une négligence ou à une sous-estimation de la souffrance .
Les professionnels de la santé sont souvent coincés dans des lacunes théoriques et méthodologiques pour évaluer la maladie subjective, et bien plus encore pour évaluer l’impact de cette maladie sur la perception particulière du monde extérieur. Ce vide semble provenir d’une méconnaissance du corps au service du cerveau dans un schéma d’ homéostasie . A l’opposé, pour l’allostasie , c’est le cerveau qui est activement au service du corps.
Il semble que l’étude des réalités externes nie souvent notre univers interne. Carl Sagan nous a rappelé que nous sommes de la « poussière d’étoiles ». Encore plus tôt, en 1929, l’astronome Harlow Shapley avait déclaré dans le New York Times que « nos propres corps sont composés des mêmes éléments chimiques que ceux trouvés dans les nébuleuses les plus lointaines ». La neuroscience de l’intéroception reproduirait aujourd’hui, dans un dispositif paradoxal et circulaire, que le cristal de notre corps rend aujourd’hui cet éclat particulier aux étoiles.